🐱🏍Bibliographie : La morphologie du conte de Vladimir Propp... ou l'art de bâtir un récit
Introduction aux travaux de Vladimir Propp sur la structure narrative du conte, une influence méconnue et pourtant majeure pour les créateurs et créatrices d’histoires.

Il existe bien des façons de raconter une histoire, mais rares sont celles qui permettent de les structurer de manière infaillible.
Pour nourrir mes techniques d'écriture créative, je m'appuie depuis des années sur les théories et travaux de Vladimir Propp. Ce chercheur Russe est l'auteur de l'essai « Morphologie du conte », paru au début du siècle dernier. Ce livre est une influence majeure depuis sa parution, et mérite d'être mieux compris par les auteurs, conteurs et scénaristes.
Je te propose ci-dessous une synthèse des points à retenir qui en sont issus, afin de stimuler ton propre processus de création.
Qui était Vladimir Propp ?

Biographie
Pour résumer dans les grandes lignes, Vladimir Propp est un folkloriste russe, né en 1895 et mort en 1970. Il enseigne l’ethnologie à l’université de Leningrad (Saint-Pétersbourg) à partir de 1938, où ses cours sur le conte étaient particulièrement estimés.
C'est en 1928 que ce chercheur passionné a publié son œuvre la plus connue : « Morphologie du conte », que je vais résumer par la suite.
En plus d'être concis, l'ouvrage a le mérite d'être d'une grande clarté et à la portée de tous les curieux. Je ne saurais trop en conseiller la lecture à celles et ceux qui désirent écrire des récits courts.
Méthode d’écriture : pourquoi parler de Vladimir Propp ?
C'est à dessein que j’aborde son sujet. L’une des questions récurrentes auxquelles on a droit, quand on se pique de création littéraire, est « Comment faites-vous pour construire de telles histoires ? » ou « Quelle est votre technique d’écriture ? ».
Je ne considère pas avoir une recette, néanmoins j’admets volontiers qu’une bonne partie des textes peuplant mon recueil de nouvelles « Vicissitudes » s’appuient sur les théories de l’ami Vladimir.
Comme j’ai pu l’expérimenter, il est possible de mobiliser ces dernières aussi bien lors des phases d’écriture que de corrections de texte.
Autant dire qu’il s’agit d’un atout technique considérable, que je tiens à partager avec d’autres auteurs-créateurs qui n’en auraient pas connaissance.
Accessoirement, un peu de théorie fait toujours du bien pour remettre en question ses méthodes d’écriture.
Qu'est-ce que la morphologie du conte ?
La morphologie, pour rappel, est la description de l'ensemble des caractéristiques d'un sujet — en l'occurrence, le conte. Le genre a beau être antédiluvien, il demeure indétrônable pour concevoir des histoires courtes et riches en symboliques accessibles à tous.
À mon sens, c’est un peu la quintessence de l’histoire, d’autant plus qu’on peut le rapprocher des récits mythologiques.
Dans le cadre de ses recherches, Propp a tenu à vérifier s'il existait ou non des motifs narratifs typiques, récurrents et transmissibles d'un conteur à l'autre.
Or, cette intuition fut la bonne ! En s’appuyant sur un large corpus de contes populaires, le folkloriste russe est parvenu à identifier ce schéma et son fonctionnement.
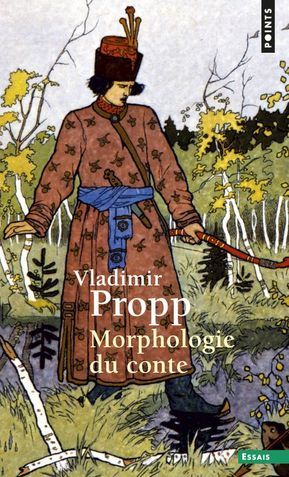
Les fonctions du conte d’après Vladimir Propp
Propp base sa réflexion sur quatre points essentiels :
- Les éléments constants, permanents, du conte, sont les fonctions des personnages, quels que soient ces personnages et quelle que soit la manière dont ces fonctions sont remplies. Les fonctions sont les parties constitutives fondamentales du conte.
- Le nombre de fonctions que comprend le conte merveilleux est limité.
- La succession des fonctions est toujours identique.
- Tous les contes merveilleux appartiennent au même type en ce qui concerne leur structure.
Pour que ce soit plus clair, précisons que, par fonction, il faut comprendre « l’action d’un personnage, définie du point de vue de sa signification dans le déroulement de l’intrigue. »
Structure commune à tous les contes
Ainsi, peu importe ce qu'on veut écrire dans un conte, on va forcément utiliser à un moment les fonctions décrites par Vladimir Propp.
Un conteur aura beau jeu d’inventer de nouveaux personnages, de nouveaux attributs ou de nouveaux noms, en aucun cas il ne réinventera leur rôle fondamental dans la progression de l’intrigue.
Puisque l'articulation des fonctions, la structure du conte donc, s'avère invariable, tout ce que nous pouvons faire en tant qu’auteurs est d’acter son existence et s'arranger avec. La créativité du conteur réside dès lors dans les formes qu'il emploie, dans l'originalité et la beauté de l'univers qu'il décrit.
Même si les thèses de Propp laissent assez de place pour s'exprimer — heureusement ! - elles invitent à relativiser et à examiner avec humilité ce que l'on écrit. Le conteur est un recycleur avec des pinceaux chargés de couleurs. Ni plus ni moins.
La morphologie du conte pour l'analyse de scénario
Ami lecteur, veux-tu que j'exprime le fond de ma pensée ?
La morphologie du conte, simple, sobre et efficace, est un sublime argument à coller contre la tempe d’écrivain.e.s dont l'orgueil réside dans la conception alambiquée de récits, ou contre le front de leurs lecteur.ice.s extatiques.
Car oui, on peut tout à fait s'amuser à décomposer un roman ou un scénario, même labyrinthique ou gorgé de flashbacks en se servant des travaux de Propp. Il est aisé de retrouver l'archétype qu'il a démontré.
Une fois qu'on a saisi ceci, écouter qui que ce soit gloser et pavoiser sur la « folle inventivité dans la structure de ce texte » devient une perte de temps.
Une structure narrative, aussi extraordinaire soit-elle, n'est qu'une structure, rien de plus. Elle ne fait pas tout ! Encore faut-il avoir quelque chose à dire, quelque chose à raconter, comme peuvent le faire des auteurs tels que Hal Duncan, pour ne citer que lui. Là, d'accord, la question de la structure devient bluffante.
Autrement, il s'agit juste d’esbroufe et de pose médiatique.
Écrire un conte traditionnel : équation à deux paramètres
Mais je cesse là la digression, revenons à nos moutons. En bref comme en cent, une histoire repose sur deux éléments, à savoir les personnages et les évènements vécus.
Pour écrire un conte, il faut tenir compte des spécificités de chaque fonction et de ses enchaînements logiques.
Les événements du conte
L’histoire se déroule toujours selon un ordre bien précis, résumé par la formule à l'apparence barbare ci-dessous. Pas d'affolement, la signification réside dans le tableau disponible en .pdf téléchargeable ci-dessous.
β γ δ ε ζ η θ A B C ↑ D E F G {H/M I J/N} K ↓ Pr-Rs O L Q Ex T U Wo
Cet ordre est immuable, néanmoins chaque étape peut être zappée individuellement. Du moins tant que l’histoire décrite reste cohérente. Quitte à rabâcher, répétons-le : l'essentiel est l’articulation des fonctions entre elles. C'est ainsi qu'on peut se trouver avec des structures telles que :
β A B C ↑ D E F G H I J K
Bien entendu, le pdf ne comprend que les fonctions générales. En pratique, celles-ci se subdivisent en de nombreuses variantes, ce qui explique la diversité et l'originalité des contes. La lecture de l'ouvrage de Propp, que cet article ne peut prétendre résumer entièrement, permettra d'approfondir plus avant la question.
Il est à noter que certaines fonctions possèdent trois variantes :
- Pos : résultat positif de la fonction
- Neg : résultat négatif de la fonction
- Contr : résultat opposé à la signification de la fonction
Par exemple, si le héros ne réagit pas de la bonne façon au donateur, il faut noter E neg lorsque l'on compose sa formule. Cela permet de nuancer l'analyse de la progression de l'histoire. C'est que tout ne saurait pas être rose pour nos héros ! Eux aussi ont le droit de se planter, de temps à autre...
Les fonctions de personnages de Propp
En parlant de héros, d'ailleurs… Vladimir Propp distingue 7 fonctions de personnages qui sont, parfois, cumulées par un seul protagoniste de l’histoire ou réparties entre plusieurs d’entre eux. Ces fonctions apparaissent au fil du récit à un moment déterminé, et disposent d'une sphère d'action limitée à certains passages.
Jugez plutôt :
- L’agresseur. Il apparaît deux fois dans le courant de l’action : la première fois, par surprise ; la seconde, parce que le héros le cherche. Sphère d’action = A, H, Pr.
- Le donateur. Il est rencontré par hasard, la plupart du temps à un détour de campagne. Sphère d’action = D, F.
- L’auxiliaire. L’auxiliaire magique est introduit en tant que don (F). Sphère d’action = G, K, Rs, N, T.
- La princesse (le personnage recherché) et son père. Fait partie de la situation initiale. Sphère d’action = M, J, Ex, Q, U, W.
- Le mandateur. Fait partie de la situation initiale. Sphère d’action = B.
- Le héros. Fait partie de la situation initiale. Sphère d’action = C↑, E, W. Le C↑ ne concerne que le héros quêteur, le héros-victime n’accomplit que les autres.
- Le faux héros. Fait partie de la situation initiale. Sphère d’action = C↑, Eneg, L.
En marge, il existe des personnages spéciaux qui forment la liaison entre les fonctions du conte. Dans tous les cas, les actions des personnages font écho à leur fonction dans l'intrigue, à nouveau.
Enfin, les attributs des personnages, la caractérisation de ceux-ci, sont du ressort de l’imagination du conteur. Il y a alors de quoi se faire plaisir. Dans le genre, « Bilbo le Hobbit » constitue un exemple parfait.
La recette ultime pour écrire un scénario de blockbuster ?
On pourrait croire que l'analyse menée par Propp est une méthode infaillible pour concevoir des contes, une recette facile à blockbusters... Dans les faits, cela se conteste, et plutôt deux fois qu’une.
Certes, utiliser les tableaux de Vladimir Propp permet de mieux travailler sa structure narrative, c'est indéniable ; de là à prétendre qu'il y a moyen de créer automatiquement des chefs d’œuvre avec, il y a un monde !
Une structure narrative est un simple squelette d’histoire, une base sur laquelle on doit ensuite broder, mais en aucun cas il ne s’agit de la substantifique moelle de l'histoire. Cela, c'est à nous, en tant qu’auteurs, de l'apporter.
J’ose croire en tout cas que comprendre les théories de Propp nous facilite la vie, et offre une excellente base sur laquelle concevoir de nouvelles histoires à partir d’un canevas traditionnel.
À vous de tester pour voir ce qu’il en est !

🌌 Tous les articles
🌌 Services Pro
🌌 Fictions
🌌 À propos
Tous les membres inscrits ont la possibilité de commenter cet article, de se désabonner ou de m'envoyer un feedback. Ne t'en prive pas.





